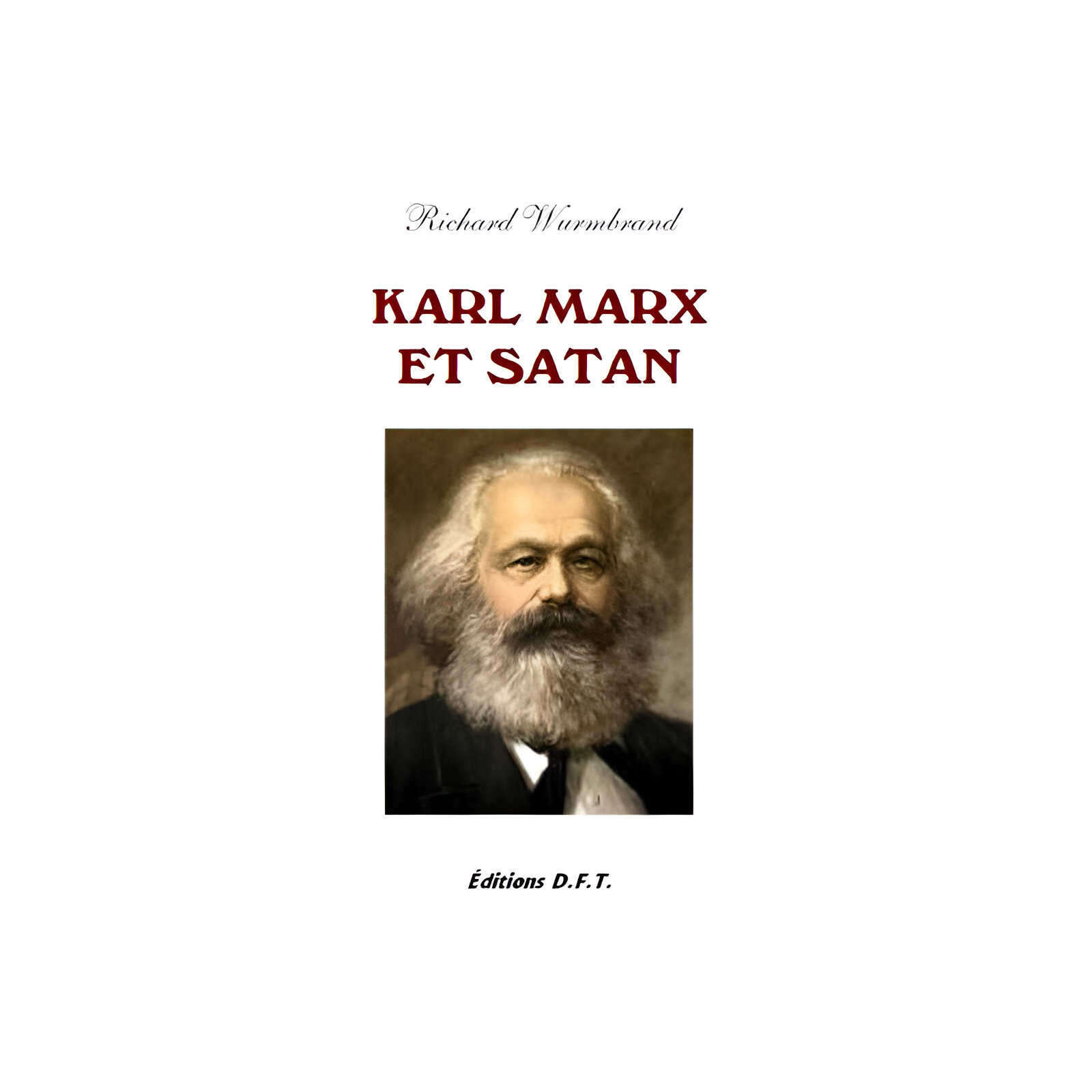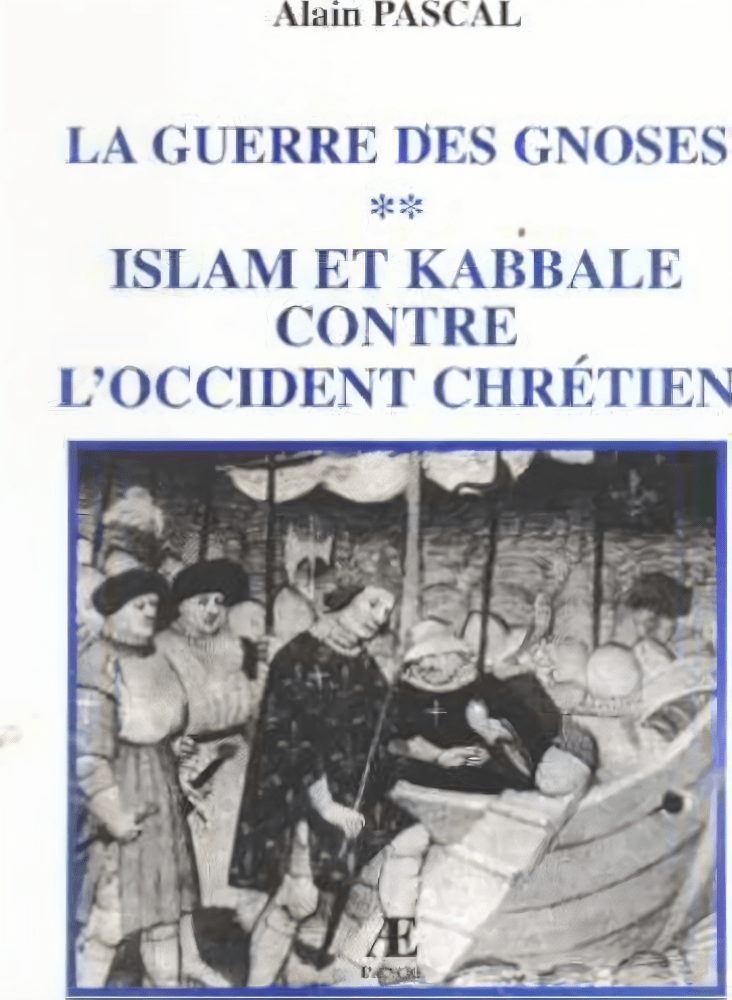Karl Marx est couramment perçu comme le critique le plus radical du capitalisme et de ses architectures financières. Pourtant, une lecture attentive de ses écrits journalistiques durant la guerre de Crimée révèle une position plus ambivalente, marquée par une convergence implicite entre son discours idéologique et les intérêts financiers des puissances libérales capitalistes. Cet article examine les prises de position de Marx pendant la guerre de Crimée en les recontextualisant dans leur cadre historique et géopolitique, à l’intersection de la théorie des classes, des stratégies impériales et de la logique du capital financier. Il soutient que l’appui de Marx à l’Empire ottoman et son hostilité à la Russie tsariste recoupent, structurellement sinon intentionnellement, les impératifs des élites bancaires de l’époque, soulevant ainsi des questions essentielles sur les intrications entre pensée révolutionnaire et hégémonie financière.
Introduction : Marx, lutte des classes et journalisme politique
L’œuvre de Karl Marx est indissociable de sa critique du capitalisme, conçu comme un mode de production historique fondé sur l’exploitation et le conflit de classes. Dans Le Capital, les Grundrisse ou encore le Manifeste du Parti communiste, Marx analyse les contradictions internes de la société bourgeoise, annonçant sa fin inévitable par la révolution prolétarienne. Toutefois, Marx n’était pas uniquement un théoricien de l’économie politique ; il fut aussi un journaliste engagé, collaborant activement avec le New York Tribune dans les années 1850.
Cette facette moins connue de son œuvre constitue un terrain d’observation privilégié pour saisir sa pensée politique appliquée aux conflits contemporains. Parmi ceux-ci, la guerre de Crimée (1853–1856) se détache comme un moment géopolitique majeur. Les articles de Marx sur cette guerre ont été classiquement lus comme des plaidoyers contre l’autocratie russe et en faveur des forces progressistes. Cependant, une analyse plus fine met en lumière une convergence – non intentionnelle mais significative – entre ses positions idéologiques et les intérêts stratégiques et financiers des puissances occidentales.
Contexte géopolitique : la guerre de Crimée et la Question d’Orient
La guerre de Crimée, qui se déroula de 1853 à 1856, opposa la Russie à une coalition composée de l’Empire ottoman, de la France, du Royaume-Uni et du royaume de Sardaigne. Ce conflit prit racine dans les rivalités impériales liées au déclin ottoman, à l’accès stratégique aux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi qu’aux tensions religieuses autour des lieux saints chrétiens en Palestine. Il s’agit de l’une des premières guerres de l’ère moderne à bénéficier d’une large couverture médiatique, marquée par le rôle naissant de la presse internationale et des correspondants de guerre.
Dans ce contexte, la Grande-Bretagne et la France cherchèrent à préserver l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman afin d’endiguer l’expansion russe vers les Balkans et la mer Noire. Cette politique répondait à une double exigence : maintenir l’équilibre géopolitique européen et garantir la solvabilité financière d’un État ottoman de plus en plus tributaire des emprunts contractés auprès des grandes maisons bancaires occidentales.
La position de Marx : un libéralisme sans capitalisme ?
Dans ses correspondances avec le New York Tribune, Marx soutint activement l’effort de guerre occidental contre la Russie. Il y voyait un affrontement entre les « idéaux démocratiques » de l’Occident et le « despotisme oriental » du tsarisme. Il alla jusqu’à présenter l’Empire ottoman comme une digue contre l’absolutisme russe.
Cette lecture est en tension avec la critique anticolonialiste et anticapitaliste que Marx développa ailleurs. La dichotomie qu’il propose entre progrès occidental et réaction orientale reprend partiellement les catégories du discours libéral de l’époque – notamment britannique –, pourtant intimement lié à l’impérialisme et aux logiques d’accumulation capitaliste.
Théorie des classes et capital financier : une convergence implicite
Une analyse plus structurelle permet de comprendre cette apparente contradiction. Les grandes maisons financières européennes – en particulier celles associées à la haute bourgeoisie juive, comme les Rothschild – avaient des intérêts massifs dans le maintien de la solvabilité ottomane. Elles finançaient les dettes souveraines, géraient les emprunts de guerre, et conseillaient les gouvernements dans leurs choix économiques.
Sans en faire un acteur conscient de ce système, il faut reconnaître que les positions de Marx pendant la guerre allaient dans le sens de cette stabilité financière. En défendant la cause ottomane et en diabolisant la Russie, il participait à légitimer l’intervention occidentale et, de facto, à sécuriser les investissements liés à la dette impériale.
Cette convergence est d’autant plus intrigante que Marx s’inscrit dans une tradition intellectuelle issue de l’économie politique classique – Smith, Ricardo – qu’il radicalise. Il hérite de ces auteurs une vision selon laquelle la bourgeoisie constitue une force historiquement progressiste face aux formes féodales. Ce cadre le conduit parfois à épouser, dans les faits, les causes portées par les puissances libérales, même si leur fondement capitaliste est dénoncé ailleurs.
L’héritage rabbinique et le silence sur la finance juive
La relecture des écrits de Marx sur la guerre de Crimée impose également de replacer son discours dans le contexte de ses origines sociales et familiales. Du côté maternel, Marx descendait d’une lignée rabbinique prestigieuse : les Pressburg, famille de rabbins, juristes et négociants juifs installés aux Pays-Bas et en Allemagne. Cette filiation le rattachait à une bourgeoisie juive éclairée, insérée dans les dynamiques intellectuelles et financières de l’Europe du XIXe siècle. Même si Marx rompit formellement avec toute religiosité, cette ascendance joua probablement un rôle latent dans sa perception des forces sociales et dans la géographie de ses critiques.
Ce contexte est d’autant plus significatif que Marx, pourtant virulent à l’égard du capital bancaire en général, se montra particulièrement mesuré – voire muet – lorsqu’il s’agissait de nommer les ramifications financières juives, notamment la maison Rothschild. Cette réticence, que certains biographes interprètent comme un biais de loyauté implicite ou une forme de calcul politique, s’exprime d’autant plus clairement dans ses écrits sur la guerre de Crimée. Là où il fustige l’aristocratie foncière, l’autocratie tsariste ou les « bourgeois du continent », il reste remarquablement discret quant aux circuits bancaires juifs pourtant centraux dans le financement du conflit. Même dans son pamphlet de 1844, La question juive, s’il critique « l’esprit marchand » et la « religion de l’argent », il reste abstrait, préférant l’allégorie à la dénonciation nominative des grandes maisons bancaires.
Ce silence relatif devient d’autant plus frappant dans le contexte de la guerre de Crimée, où la convergence entre ses positions politiques et les intérêts bancaires juifs – notamment Rothschild – atteint une intensité structurelle. Il ne s’agit pas ici d’accuser Marx d’opportunisme, mais de constater qu’il opère une sélection dans ses cibles : l’autocratie tsariste est clouée au pilori, l’expansionnisme russe vilipendé, tandis que les puissances libérales endettées auprès de banques juives restent étrangement préservées de toute dénonciation explicite.
Portée théorique et réévaluation critique
Ce moment de convergence entre discours révolutionnaire et intérêts financiers pose plusieurs questions. Le marxisme peut-il, dans certains contextes, s’aligner structurellement sur les intérêts bourgeois qu’il entend combattre ? Peut-on vraiment séparer radicalité idéologique et stratégies géopolitiques lorsque les ennemis sont communs ?
La guerre de Crimée montre que, même chez les penseurs les plus critiques, des alignements tactiques ou structurels peuvent survenir. Ce constat ne réduit pas la portée de Marx mais invite à complexifier la lecture de ses écrits, en intégrant les contraintes matérielles et idéologiques dans lesquelles ils furent produits.
En final
L’analyse des écrits de Marx sur la guerre de Crimée met en lumière une entente implicite avec les logiques du capital financier occidental. Son soutien à l’Empire ottoman et son rejet du tsarisme ont, volontairement ou non, contribué à conforter une certaine architecture géopolitique favorable aux puissances libérales et à leurs intérêts économiques.
Loin de discréditer Marx, cette relecture offre une compréhension plus fine de la dialectique entre discours critique et réalité historique. Elle rappelle que la pensée révolutionnaire ne se déploie jamais dans le vide, mais toujours dans un champ de forces où se croisent alliances provisoires, objectifs contradictoires et logiques de reproduction des rapports de pouvoir.
Khaled Boulaziz