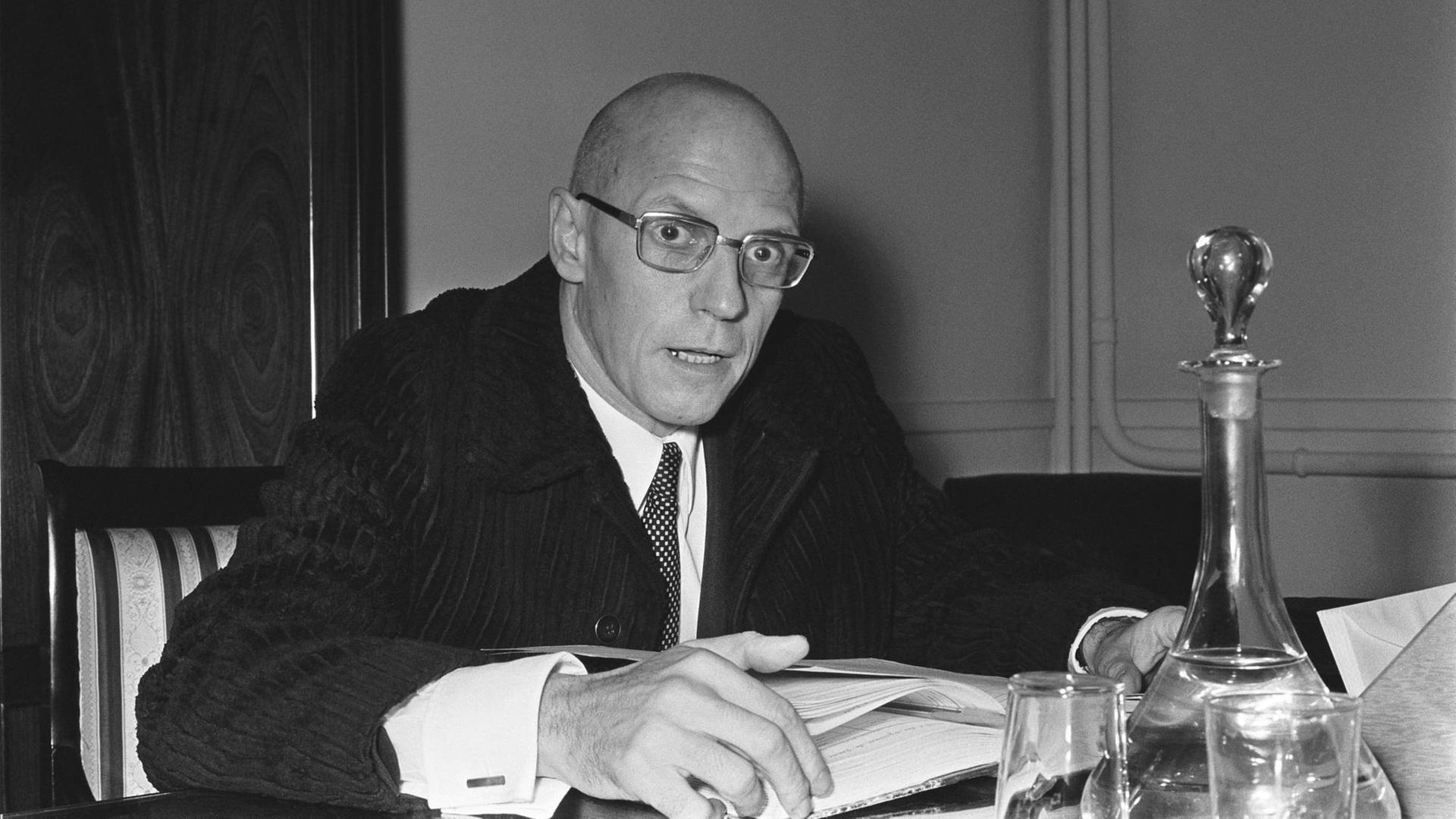L’hypothèse du proto-indo-européen (PIE) et la théorie trifonctionnelle de Georges Dumézil (1) ont longtemps dominé les études sur les origines culturelles et linguistiques de l’Europe. Ces modèles postulent une unité originelle, reliant les peuples européens aux anciennes civilisations indo-aryennes, comme si l’Inde védique et la Grèce antique partageaient un tronc commun fondamental. Pourtant, ces hypothèses sont hautement spéculatives et profondément idéologiques : elles reposent sur des reconstructions linguistiques incertaines et sur une vision homogénéisante de l’histoire, qui masque la complexité des échanges et des influences entre civilisations.
Dumézil, en particulier, cherche à imposer une grille de lecture structuraliste sur les mythes indo-européens, réduisant les sociétés anciennes à une tripartition rigide entre souveraineté, guerre et production. Cette approche est problématique, car elle suppose une continuité idéologique et structurelle entre des cultures profondément distinctes, et tend à effacer les influences orientales directes dans la formation de l’Europe. Or, c’est précisément ce refoulement de l’Orient qui est au cœur de la critique foucaldienne. Contrairement aux approches indo-européennes qui cherchent à unifier l’histoire des peuples eurasiens sous une origine commune, Michel Foucault propose une analyse radicalement différente : l’Occident ne se définit pas par une racine commune indo-européenne, mais par une séparation fondatrice vis-à-vis de l’Orient, et plus particulièrement du Proche-Orient.
Loin d’être un simple espace lointain et exotique, le Proche-Orient est l’origine spirituelle et intellectuelle de l’Occident, notamment à travers le christianisme. Pourtant, l’Occident s’est construit contre cet héritage, en traçant une ligne de partage qui lui permet d’affirmer sa propre rationalité. C’est cette frontière, mouvante et paradoxale, que Foucault analyse dans L’Histoire de la folie, montrant comment l’Orient devient un refoulé nécessaire à l’identité européenne : à la fois source de vérité et d’inspiration, mais aussi altérité absolue servant à justifier l’hégémonie occidentale.
Dans cette perspective, il ne s’agit plus de rechercher une origine commune mythifiée, mais de comprendre comment l’Occident a intégré et exclu simultanément son héritage oriental. C’est ce que nous allons explorer en mettant en lumière la manière dont l’Orient a été construit comme une altérité fondatrice, bien plus influente que les mythes indo-européens ne veulent le laisser croire.
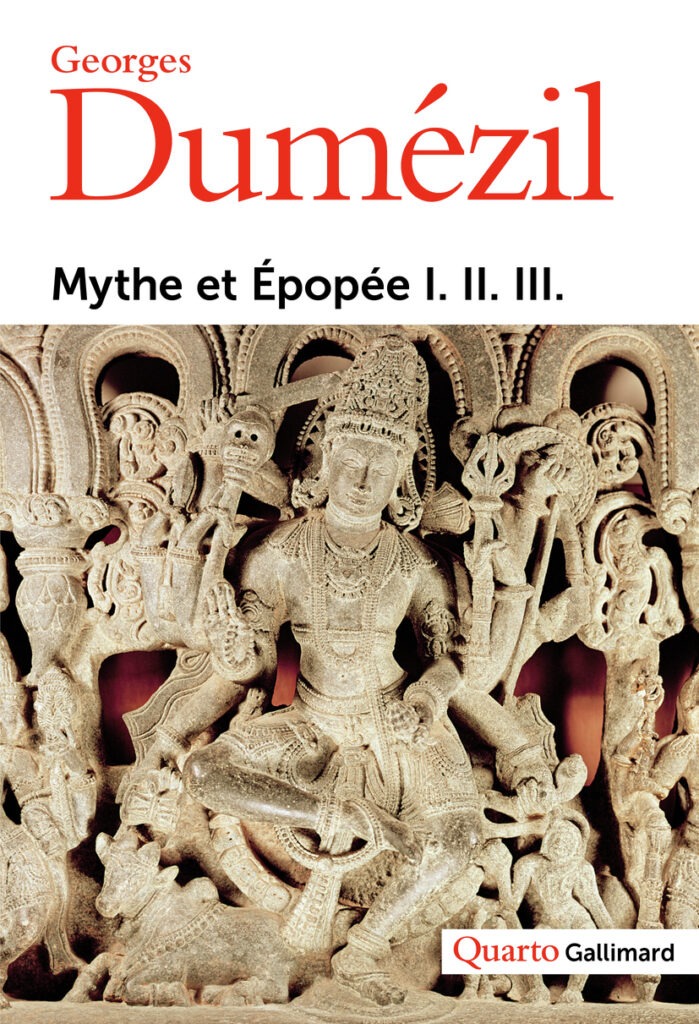
1. L’Orient de Dumézil et l’Orient de Foucault : deux constructions différentes
La vision de Dumézil repose sur une origine indo-européenne, cherchant à relier l’Europe à l’Inde par une langue et une culture ancestrales communes. Il explore une parenté mythologique et linguistique entre les peuples de l’Inde védique, de la Grèce antique et de Rome, montrant une structure commune à leurs récits et leurs croyances. Cet Orient est donc un Orient lointain, pré-historique, lié aux racines profondes des peuples européens.
Foucault, en revanche, parle d’un Orient plus proche, celui du Proche-Orient et du bassin méditerranéen, qui a influencé directement l’Occident par le biais des grandes traditions monothéistes. Le christianisme, qui naît en Palestine et se développe dans l’Empire romain, constitue un héritage oriental essentiel à la construction de l’Occident médiéval. De même, la philosophie grecque elle-même a été en dialogue avec les savoirs du Proche-Orient et du monde arabe, notamment lors de la transmission des textes antiques par les penseurs musulmans au Moyen Âge.
2. L’Orient du Proche-Orient : une origine refoulée de l’Occident
Foucault suggère que l’Occident s’est construit en opposition à un Orient qu’il ne cesse pourtant de convoquer. Cela est particulièrement visible avec la chrétienté :
- Le christianisme naît en Orient, mais devient la religion dominante de l’Occident.
- L’Europe médiévale regarde Byzance comme une civilisation à la fois familière et étrangère.
- À la Renaissance et aux Lumières, l’Orient chrétien et musulman devient un objet d’étude et de fascination.
Cette ambiguïté rappelle l’analyse d’Edward Said dans L’Orientalisme. Said montre comment l’Europe a construit un discours orientaliste, décrivant le Proche-Orient tantôt comme une source de sagesse spirituelle (le « mysticisme oriental »), tantôt comme un espace de danger et de chaos. L’Orient devient ainsi une altérité essentielle, à la fois nécessaire et rejetée, un lieu où l’Occident cherche son origine tout en s’en distinguant pour affirmer sa propre identité.
3. L’Orient comme « limite » et « nuit du commencement »
Foucault décrit l’Orient comme une « nuit du commencement », une obscurité originelle que l’Occident tente d’éclairer par sa raison. Cela s’observe aussi bien dans la conquête coloniale que dans la manière dont l’Europe a construit sa propre histoire spirituelle :
- L’Orient biblique est à l’origine du christianisme, mais l’Europe cherche à l’occidentaliser en imposant sa propre lecture du dogme.
- L’Orient islamique est perçu comme une altérité menaçante (notamment à travers les croisades et l’Empire ottoman), mais aussi comme un réservoir de savoirs scientifiques et philosophiques.
- L’Orient ottoman et arabe est au cœur des imaginaires coloniaux du XIXᵉ siècle, fascinant et menaçant à la fois.
Cette dualité entre origine spirituelle et altérité radicale structure l’histoire de l’Occident. Contrairement à Dumézil, qui cherche à réunir l’Europe et l’Inde dans un cadre indo-européen, Foucault insiste sur une rupture, une ligne de partage qui maintient l’Orient à la fois comme fondement et comme autre absolu.
4. Conclusion : une opposition fondatrice
L’Orient de Foucault n’est donc pas celui de Dumézil : ce n’est pas un passé commun oublié, mais un altérité construite qui permet à l’Occident de se définir. Cette opposition est à la fois historique, religieuse et philosophique. Elle s’incarne dans la manière dont l’Europe a intégré et refoulé son héritage oriental : en transformant un christianisme oriental en religion occidentale, en diabolisant l’islam tout en s’inspirant de sa pensée, ou encore en idéalisant un Orient biblique et exotique tout en l’excluant de la modernité.
Ainsi, ce « grand partage » dont parle Foucault est plus qu’un simple clivage géographique : il est une barrière mentale et culturelle, une construction historique qui façonne encore aujourd’hui les relations entre l’Occident et l’Orient.
Khaled Boulaziz
(1) https://www.gallimard.fr/catalogue/mythe-et-epopee-i-ii-iii/9782072908910