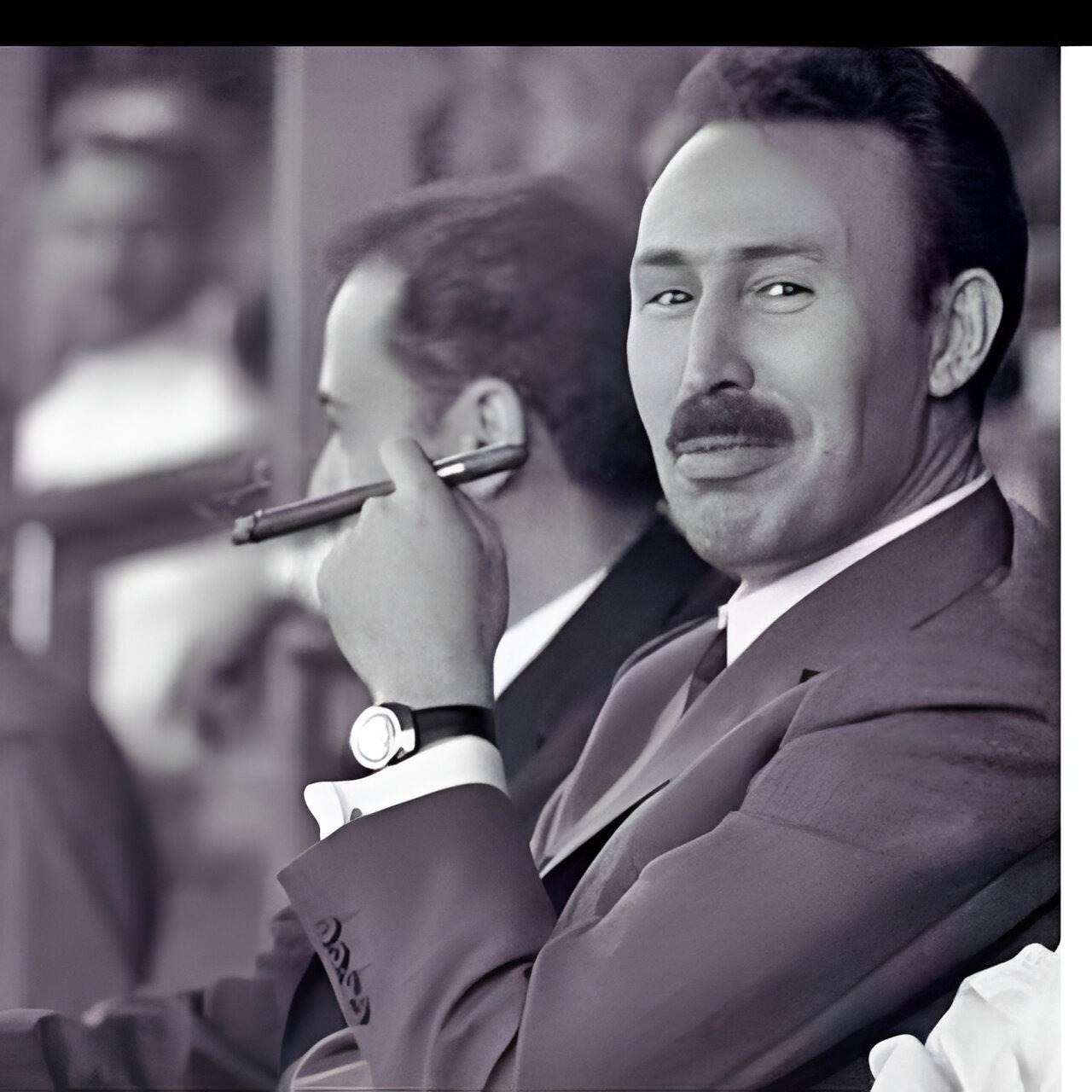L’indépendance algérienne, acquise au terme d’une guerre d’une rare intensité contre la puissance coloniale française, a produit une configuration politique singulière : celle d’un État dont la colonne vertébrale fut dès l’origine son armée. L’étude minutieuse des trajectoires biographiques de 113 officiers de l’Armée Nationale Populaire (ANP), héritière de l’Armée de Libération Nationale (ALN), révèle des dynamiques de pouvoir profondément enracinées dans l’histoire, la géographie et la sociologie de la guerre d’indépendance. Cet essai propose une analyse politique de ces données biographiques, afin de montrer que l’ANP s’est construite non seulement comme une institution militaire, mais aussi comme un organe de centralisation du pouvoir, façonné par des logiques de légitimation historique, d’exclusion régionale et de reproduction sociale.
I. La guerre comme matrice de légitimation politique
Les données révèlent que la moyenne d’âge des officiers de l’ANP en 1962 était de 26 ans. Ces hommes ont donc fait leur entrée dans l’armée indépendante jeunes, pour beaucoup à la sortie de l’adolescence. Ils n’ont pas connu d’autre milieu que celui de la guerre. Leur identité, forgée dans le feu du maquis ou dans les camps de formation aux frontières, s’est trouvée réinvestie dans la construction de l’État. Cette guerre, qui aurait pu n’être qu’une parenthèse violente, devient pour eux un horizon de vie. La militarisation de leur trajectoire biographique s’est ainsi prolongée dans la militarisation de l’État.
Cette continuité n’est pas anodine. Dans un pays exsangue, où l’administration coloniale s’est effondrée avec le départ des Européens, l’armée constitue la seule institution dotée d’une structure et d’une hiérarchie. Elle s’impose alors comme le socle de l’ordre nouveau. Ce phénomène est classique dans l’histoire des États postcoloniaux, mais en Algérie, il prend une intensité particulière : l’ALN, bien que militairement moins décisive que le front diplomatique du FLN, tire un prestige immense de sa résistance à une grande puissance. L’ANP, son héritière directe, hérite de ce capital symbolique qu’elle transformera en légitimité politique.
II. Une armée de l’Est : régionalisme et monopole du pouvoir
L’une des découvertes majeures de l’étude est la surreprésentation du département de Constantine dans les lieux de naissance des officiers. Près de 60 % d’entre eux en sont originaires, alors que cette région représentait 40 % de la population en 1936. À l’inverse, les départements d’Alger et d’Oran sont sous-représentés. Cette concentration géographique est révélatrice de la façon dont les réseaux régionaux ont structuré la hiérarchie militaire et, partant, la distribution du pouvoir politique.
Cette centralité de l’Est trouve sa racine dans l’histoire du nationalisme algérien. C’est dans cette région que le Parti du Peuple Algérien (PPA) a trouvé ses bastions les plus solides. C’est aussi là que le soulèvement de 1954 s’est déclenché avec le plus de vigueur. Il est donc logique que l’ALN, née de cette dynamique, soit d’abord une armée de l’Est. Mais cette logique historique devient ensuite une logique politique : les officiers issus de cette région dominent l’ANP et, par extension, l’État.
L’expression populaire du « triangle BTS » (Batna-Tébessa-Souk Ahras) vise à désigner cette concentration du pouvoir. Pourtant, l’analyse détaillée montre que ce sigle, bien que séduisant, ne correspond pas à une réalité statistique rigoureuse. Seuls 7,5 % des officiers étudiés sont effectivement nés dans ces trois villes. Le « BTS » est un raccourci commode, mais réducteur, qui masque la complexité des dynamiques régionales. Ce que l’on peut affirmer, en revanche, c’est que l’Est algérien, au sens large, a longtemps constitué le vivier principal du pouvoir militaire.
III. Origines sociales et scolaires : reproduction d’élite
Les trajectoires biographiques révèlent aussi un autre aspect fondamental de la construction du pouvoir : la reproduction sociale. Beaucoup d’officiers de l’ANP sont issus de familles de notables, de propriétaires terriens, ou d’anciens caïds et bachaghas. Chez les anciens de l’armée française, l’héritage familial militaire est souvent décisif : le père, l’oncle, ou un frère a servi dans l’armée coloniale. L’intégration à l’ANP apparaît donc, dans bien des cas, comme la continuation d’une tradition familiale d’autorité.
D’autres encore, moins nombreux, sont issus de familles pauvres et ont trouvé dans l’armée une voie de promotion sociale. Mais même dans ces cas, l’accès au sommet semble dépendre moins des compétences techniques que de l’appartenance à des réseaux. En effet, le niveau scolaire de nombreux officiers, surtout dans les premières décennies, est très faible. Certains généraux sont illettrés. L’exemple de Chadli Bendjedid, président de la République avec une instruction sommaire, en est emblématique. Dans un contexte de pénurie de cadres, c’est le capital symbolique de la guerre, et non la compétence technique, qui constitue le principal critère d’accès au pouvoir.
IV. Exclusion et verrouillage du pouvoir
La centralisation du pouvoir militaire s’est aussi accompagnée d’un processus d’exclusion. Les régions qui se sont opposées à l’armée des frontières en 1962, notamment la Kabylie (wilaya III) et l’Algérois (wilaya IV), ont vu leurs combattants marginalisés dans l’ANP. Cette marginalisation politique a des conséquences durables. La composition régionale de l’armée devient ainsi l’un des enjeux majeurs de la lutte pour le pouvoir. Les perdants de 1962, pour reprendre l’expression utilisée dans le texte, n’ont pas disparu. Mais ils ont été écartés des cercles de décision.
En parallèle, les liens familiaux entre officiers se multiplient : mariages entre sœurs et frères d’armes, enfants devenus officiers à leur tour. Ces dynamiques de clan verrouillent l’accès au sommet. Le pouvoir militaire se ferme sur lui-même, devenant une aristocratie d’un genre nouveau. Loin d’être une simple institution républicaine, l’ANP se structure comme une caste.
V. Objections et réponses
On pourrait objecter que l’ANP s’est démocratisée avec le temps, que la provenance géographique des officiers s’est diversifiée, et que les formations techniques ont progressé. Ces éléments sont vrais, mais ils ne modifient pas les fondements sur lesquels l’armée s’est initialement construite. L’ouverture relative des années 1980-1990 ne fait que recouvrir des dynamiques plus profondes de continuité.
On pourrait aussi affirmer que le FLN détient le pouvoir politique, et que l’armée n’en est qu’un instrument. Pourtant, l’histoire politique de l’Algérie dément cette idée : les coups d’État militaires (1965, 1992), le rôle des généraux dans les nominations présidentielles, et la prédominance de l’ANP dans la sécurité intérieure, montrent que l’armée est bien plus qu’un simple outil. Elle est un acteur politique à part entière, souvent l’arbitre ultime.
Conclusion
L’analyse des trajectoires biographiques des officiers de l’ANP révèle que l’armée algérienne ne s’est pas simplement construite comme une force militaire, mais comme un appareil de pouvoir. Les logiques de légitimation fondées sur la guerre, les dynamiques régionales, les réseaux familiaux et la faible mobilité sociale ont produit une élite militaire stable, fermée et puissante. Loin de se dissoudre avec le temps, ces structures ont façonné l’État algérien lui-même, au point que l’on ne peut penser la politique algérienne sans penser l’armée.
Ce constat invite à reconsidérer l’idée selon laquelle la guerre aurait naturellement produit une élite légitime. Si cette élite est bien issue de la guerre, elle en a aussi gardé les méthodes : exclusion, centralisation, contrôle. La militarisation de l’État n’est donc pas un accident, mais la conséquence logique de la manière dont l’ANP a été constituée. Reste à savoir si un autre modèle est possible – ou si la guerre d’indépendance continue, par ses fantômes, à gouverner le présent.
Khaled Boulaziz