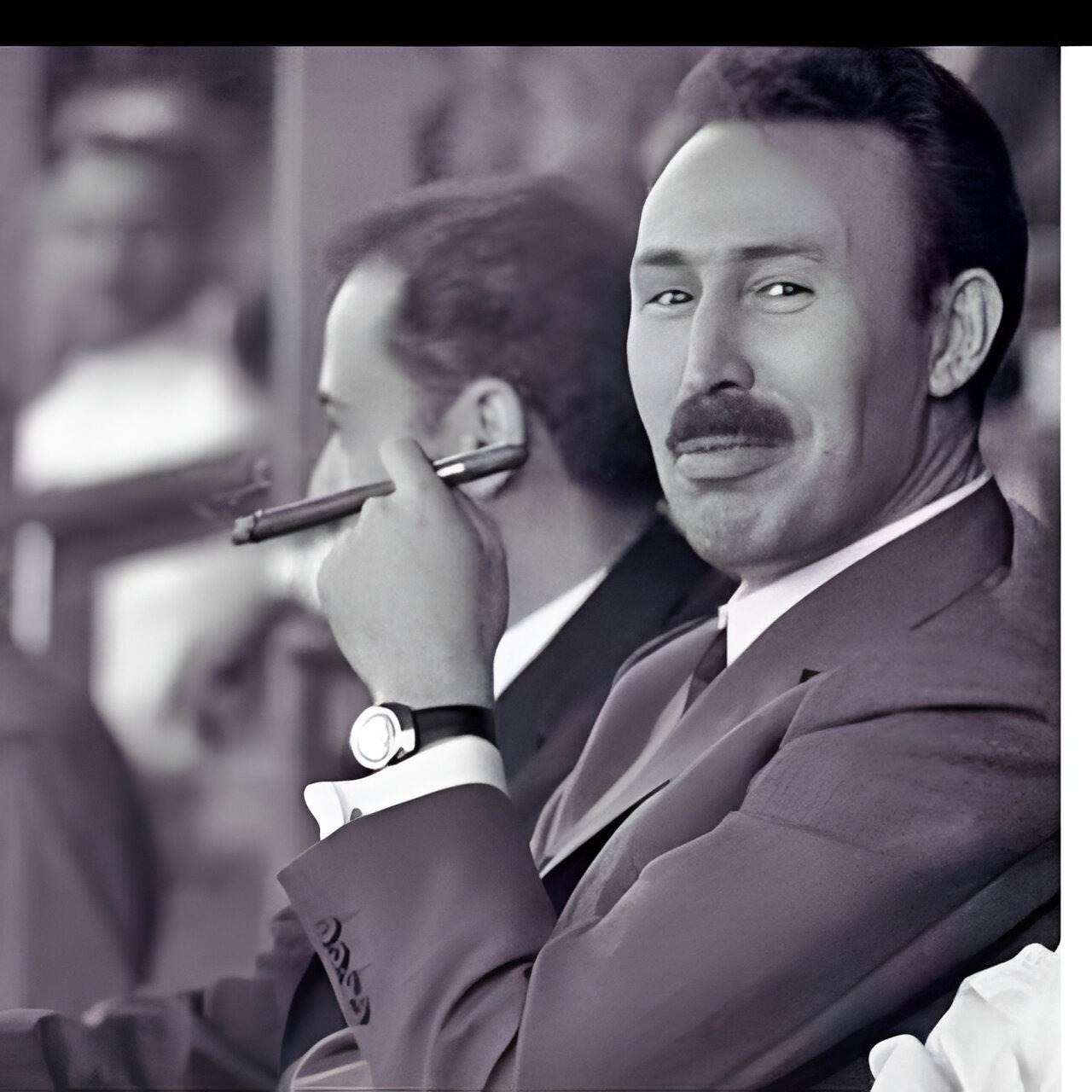Une révolution confisquée
En 1962, l’Algérie sortait victorieuse de sa guerre de libération nationale, mais profondément fracturée. Après sept ans et demi de lutte acharnée contre le colonialisme français, le pays ne donna pas naissance à une république libre et démocratique. Ce fut plutôt la prise du pouvoir par l’armée, orchestrée par le colonel Houari Boumédiène et l’Armée des frontières — une force restée à l’extérieur du pays pendant la guerre, épargnée par les sacrifices du maquis.
Boumédiène ne protégea pas la révolution : il la détourna. Il ne se contenta pas de s’emparer de l’État ; il entreprit de détruire systématiquement l’élite civile et politique qui avait préparé l’indépendance. À sa place, il érigea une oligarchie militaire rétrograde et autoritaire.
La marche sur Alger
L’ascension de Boumédiène fut rapide, méthodique et implacable. À la veille du cessez-le-feu, le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) semblait destiné à diriger le pays. Composé de figures telles que Ferhat Abbas, Benyoucef Benkhedda et Krim Belkacem, il avait porté la voix de la révolution sur la scène internationale et négocié les Accords d’Évian.
Mais il lui manquait ce que Boumédiène possédait : des troupes, des chars, une armée intacte. Pendant que les wilayas de l’intérieur s’épuisaient au combat, l’Armée des frontières restait disciplinée, organisée, et loyale à un seul homme. À l’été 1962, Boumédiène fit marcher ses forces vers Alger, affronta la Wilaya IV et entra dans la capitale en septembre. La révolution avait changé de mains — des mains civiles à celles des militaires.
Éliminer les révolutionnaires
La prise du pouvoir fut suivie d’une purge méthodique. Boumédiène n’élimina pas seulement ses rivaux : il anéantit l’élite politique et intellectuelle de la révolution. Il fit emprisonner, exiler, voire assassiner des figures majeures de la lutte pour l’indépendance.
Ferhat Abbas fut assigné à résidence, puis exilé. Krim Belkacem, signataire des Accords d’Évian, fut assassiné à Francfort en 1970. Mohamed Khider, ancien trésorier du FLN, fut abattu à Madrid. Ces exécutions ciblées étaient autant d’attaques contre la mémoire de la révolution.
La politique civile écrasée
Boumédiène ne voulait pas seulement le pouvoir : il voulait éradiquer toute alternative civile. Les partis furent interdits, les syndicats muselés, la presse contrôlée, l’université surveillée. Le FLN, vidé de son pluralisme révolutionnaire, devint un simple outil administratif.
À la place, Boumédiène promut une nouvelle classe dirigeante : des officiers souvent issus de l’armée française, reconvertis en gardiens d’une indépendance qu’ils n’avaient pas conquise. Le paradoxe était total : les anciens instruments du colonialisme devenaient les nouveaux maîtres du pays.
Le pouvoir aux mains des militaires
Cette nouvelle élite n’avait ni formation politique, ni culture démocratique, ni réelle instruction. L’État qu’ils construisirent était rigide, centralisé, autoritaire, fermé au débat. Le langage politique fut remplacé par des slogans ; la population réduite au silence.
La modernisation économique, inspirée des modèles soviétiques, masquait une réalité bien plus dure : un État sans société, un pouvoir sans légitimité, une autorité fondée non sur le droit mais sur la peur.
Effacer la mémoire collective
Boumédiène ne réécrivit pas seulement la structure de l’État : il falsifia l’histoire. Le récit de la guerre d’indépendance fut recentré autour de l’Armée des frontières. Le rôle du maquis fut minimisé, les héros civils oubliés ou calomniés.
Une génération entière apprit à l’école que Boumédiène avait conduit le pays à la victoire. En réalité, il n’en fut que le pilleur, arrivé après la bataille pour en confisquer les fruits.
Un régime sans héritiers légitimes
En détruisant l’élite politique civile et en concentrant le pouvoir dans l’armée, Boumédiène bâtit un système incapable d’évoluer. Il n’y avait ni mécanisme de succession, ni tolérance à la critique, ni tradition de dialogue. Le régime reposait sur la répression et la loyauté personnelle.
À sa mort en 1978, les structures autoritaires qu’il avait mises en place perdurèrent, dirigées par ses héritiers : une génération d’officiers et de sécuritaires sans légitimité populaire.
La voie vers la guerre civile
Au début des années 1990, la pression sociale en faveur de l’ouverture politique éclata. Mais le système, figé dans l’autoritarisme, ne put y répondre. Une courte transition démocratique (1989–1991) fut brutalement interrompue par un nouveau coup d’État militaire. Ce fut le début de la guerre civile.
Les hommes qui organisèrent la répression et les massacres étaient les mêmes que ceux que Boumédiène avait placés aux commandes vingt ans plus tôt. Ce conflit n’était pas une surprise : c’était la conséquence logique d’un pouvoir bâti sur l’exclusion, la répression, et l’anéantissement de toute opposition civile.
Une Algérie mutilée
La guerre civile des années 1990 fit plus de 100 000 morts. Mais ses racines remontent à 1962, au moment où Boumédiène choisit de détruire la possibilité même de la politique en Algérie.
Ce que l’Algérie a perdu, ce n’est pas seulement une élite intellectuelle ou une classe dirigeante, mais une culture politique, un espace de débat, une vision républicaine de l’État. En installant un pouvoir militaire fondé sur la loyauté et le silence, Boumédiène a mutilé l’avenir politique du pays.
Le vol d’une nation
Boumédiène n’a pas libéré l’Algérie — il a confisqué sa révolution. Il a écrasé son élite, effacé sa mémoire, et transformé une guerre de libération en dictature militaire. Il n’a pas bâti une nation : il a construit une forteresse.
Les hommes qu’il a promus — souvent d’anciens officiers de l’armée coloniale — ont dirigé le pays comme une caserne, incapable d’écouter, de négocier, ou de rêver.
Ce que l’Algérie attend encore aujourd’hui, c’est la restitution de sa parole, de sa mémoire, et de sa souveraineté politique. Elle attend ce que Boumédiène lui a arraché : le droit de décider par elle-même, au nom du peuple, et non des armes.
Khaled Boulaziz