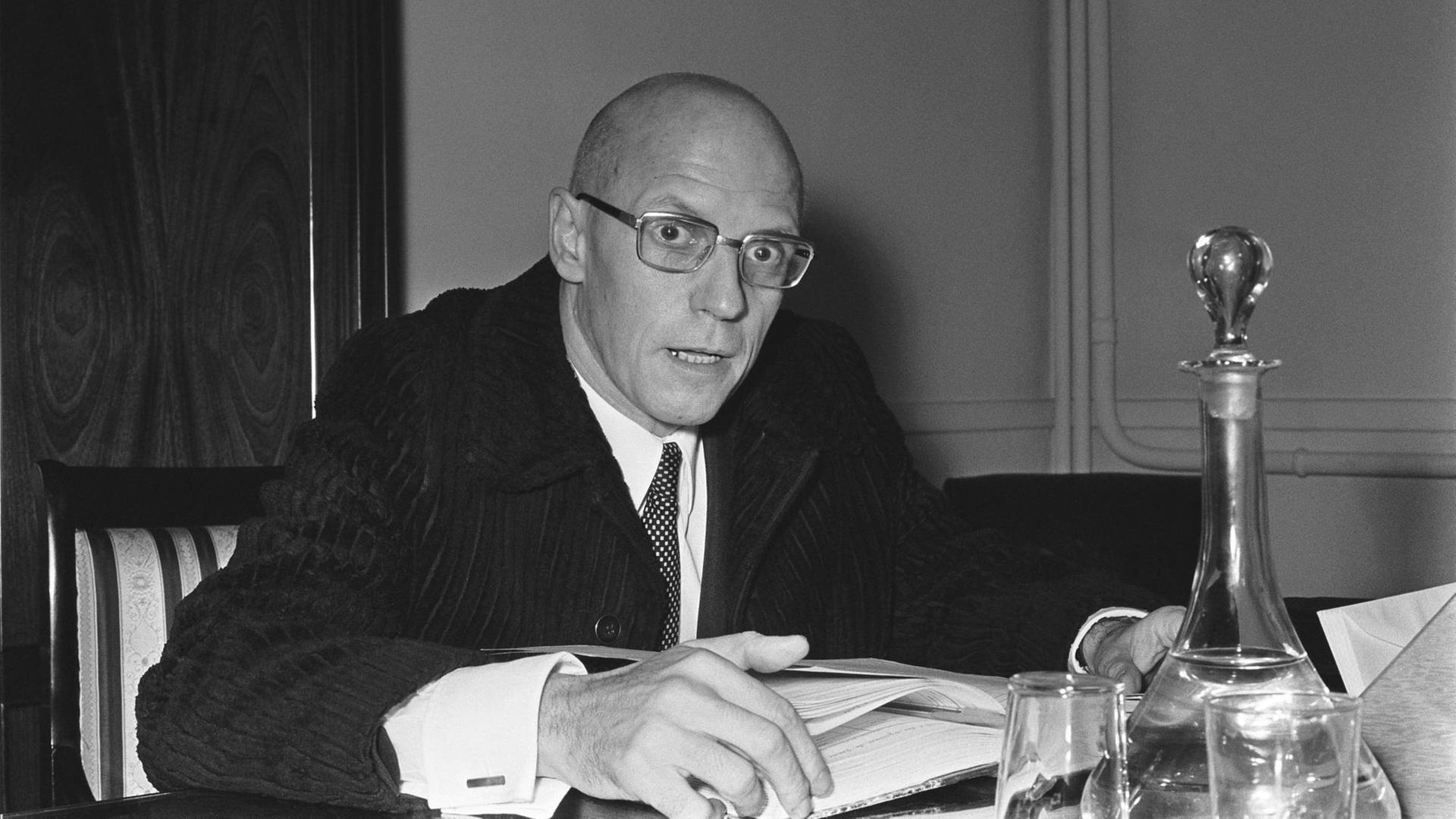Dans l’imaginaire collectif, Werner Heisenberg demeure une figure controversée. Brillant physicien allemand, il est souvent présenté comme un « physicien maudit » pour son rôle dans le programme nucléaire du Troisième Reich. Pourtant, une question essentielle se pose : pourquoi cet opprobre pèse-t-il davantage sur Heisenberg que sur Robert Oppenheimer, l’homme qui a concrétisé l’arme ayant réduit Hiroshima et Nagasaki en cendres ?
Pourquoi Heisenberg est-il vu comme l’ombre du mal alors qu’il n’a jamais conçu d’arme nucléaire pour Hitler, tandis qu’Oppenheimer, architecte d’un projet qui a provoqué des dizaines de milliers de morts instantanées, est parfois glorifié comme un héros ? Ce déséquilibre moral révèle une hypocrisie dans la perception de la responsabilité scientifique face aux horreurs de la guerre.
Heisenberg, le physicien précautionneux Loin d’être un simple exécutant du régime nazi, Heisenberg semble avoir entretenu une relation ambiguë avec le pouvoir en place. Certains historiens avancent qu’il aurait sciemment retardé le programme nucléaire allemand, conscient des dangers qu’une bombe entre les mains d’Hitler pouvait représenter. Contrairement aux accusations portées contre lui, Heisenberg n’a jamais mené l’Allemagne nazie à l’armement nucléaire. Ses travaux restèrent dans le domaine de la recherche théorique et de la production énergétique, sans jamais franchir le seuil de l’application militaire concrète.
Loin d’être un collaborateur zélé, il apparaît plutôt comme un scientifique naviguant avec prudence dans un contexte autoritaire, évitant de doter un régime sanguinaire d’une arme de destruction massive. Son manque de succès dans la course à la bombe atomique ne relève pas d’une incompétence, mais peut-être d’une volonté tacite de ne pas achever un projet aux conséquences potentiellement apocalyptiques.
Oppenheimer, le père du cataclysme Face à lui, Robert Oppenheimer incarne une autre réalité : celle d’un scientifique qui, loin de freiner l’avancée vers l’horreur, en fut le principal artisan. En dirigeant le Projet Manhattan, Oppenheimer a non seulement rendu possible la création de la bombe atomique, mais il a aussi activement participé à son développement avec une détermination sans faille. Loin d’un simple projet défensif, la bombe fut utilisée non pour mettre fin immédiatement à la guerre, mais pour asseoir la puissance des États-Unis et envoyer un message à l’Union soviétique.
Après Hiroshima et Nagasaki, Oppenheimer prit conscience de l’ampleur du désastre qu’il avait contribué à engendrer. Mais ce remords tardif ne saurait effacer la responsabilité directe qu’il porte dans l’usage d’une arme qui, pour la première fois dans l’Histoire, fit basculer l’humanité dans l’ère nucléaire par l’anéantissement instantané de populations civiles.
La science et la morale : Heisenberg contre Oppenheimer Si l’on compare ces deux figures, il apparaît que Heisenberg, loin d’être le « physicien maudit », fut celui qui, volontairement ou non, n’aboutit jamais à la création d’une bombe nucléaire pour l’Allemagne. Oppenheimer, au contraire, travailla sans relâche à la mise au point d’une arme dont l’usage fut non seulement concret, mais aussi d’une brutalité inouïe.
Alors que l’histoire retient Heisenberg dans une lumière trouble, elle hésite souvent à condamner Oppenheimer avec la même sévérité. Pourtant, si un homme doit porter le fardeau de la destruction, c’est bien celui qui a donné naissance à l’arme ultime et qui a vu, sans s’y opposer, son œuvre devenir la source d’un massacre inégalé.
L’Histoire juge souvent avec les lunettes du vainqueur. Mais si la morale doit avoir une place dans l’évaluation des responsabilités scientifiques, alors ce n’est pas Heisenberg qui mérite d’être fustigé, mais bien Oppenheimer, l’ingénieur de l’apocalypse. Car c’est lui qui, à la fin, prononça ces mots fatidiques, signe d’un aveu irréversible : « Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. »
Khaled Boulaziz